
22 avril 2025
Coup de projecteur sur Lydia Flem, Prix Scam du Parcours littéraire 2024
« Dans ses écrits, elle cherche, cisèle, traduit, avec une précision qui touche et nous émeut » : quelques mots pour se plonger dans l’univers de Lydia Flem, qui reçoit le Prix Scam du parcours Littéraire 2024. Découvrez à cette occasion l’éloge écrit en son honneur par le Comité ainsi qu’un entretien passionnant avec elle. 
L’éloge du Comité
De nombreuses lectrices et lecteurs ont découvert Lydia Flem avec le premier tome de sa trilogie familiale « Comment j’ai vidé la maison de mes parents », un de ces livres qui nous habitent et auquel on revient sans cesse. Lydia Flem sonde l’intime pour toucher le monde. Elle sort de leurs ombres ces « orages émotionnels » que nous traversons toutes et tous. Elle dessine nos émotions, nos bonheurs et nos tourments. Son travail de psychanalyste n’y est pas étranger, il ouvre les yeux sur nos expériences les plus enfouies et les nomme.
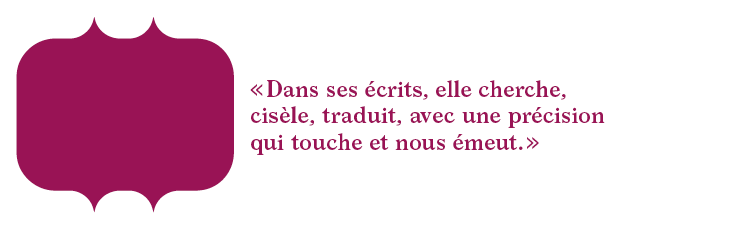
Elle dit écrire parce que la vie ne suffit pas, parce que « quelque chose dans la création veut qu’elle se poursuive, malgré nous, à travers nous. » Elle nous offre ce prolongement, à nous ses lecteurs et lectrices, et par là, elle nous enrichit infiniment.
Écrivaine, psychanalyste, elle est aussi photographe, et a consacré un travail à dénoncer les féminicides et les injustices faites aux femmes, parce que femmes, comme si elles n’appartenaient pas à la même humanité que celle des hommes.
Lydia Flem est une « Bouche bavarde, oreille curieuse » comme elle se définit elle-même. Une femme dont la curiosité est un soin, de soi, d’autrui et du monde.
Isabelle Rey, membre du Comité belge de la Scam
Lydia Flem : « Il faut continuer avec conviction »
Écrivaine, psychanalyste et photographe, Lydia Flem reçoit le prix littéraire « Parcours » de la Scam pour honorer l’ensemble de sa carrière. L’occasion rêvée d’un riche entretien avec celle pour qui l’essentiel est dans la nuance…
AD : Lydia Flem, j’aimerais commencer cette rencontre en vous demandant quel a été le déclencheur qui a placé votre vie sous le signe de l’écriture ?
LF : L’écriture est l’affaire de ma vie. Il me semble que j’ai commencé à lire et écrire dans le ventre de ma mère (rires). Chez nous, les mots étaient très importants, mes parents parlaient plusieurs langues, mon père inventait des histoires, ma mère m’en lisait, mettre en mots des choses indicibles me fascinait. J’ai écrit beaucoup de choses avant mes premiers livres : mes journaux intimes, des rédactions pour l’école, des nouvelles, des poèmes, des bouts de pièces de théâtre. Je voyais des modèles de femmes écrivaines comme la comtesse de Ségur, des modèles d’héroïnes comme Alice au pays des merveilles ou Les quatre filles du docteur March, et je m’identifiais déjà aux personnages féminins qui écrivaient. Plus tard, la psychanalyse est devenue pour moi l’un des chemins pour la recherche des mots justes.
AD : Écriture et psychanalyse sont-elles deux facettes d’une même tentative de raconter ce qui résiste à la pensée consciente ?
LF : Oui, la psychanalyse et l’écriture sont intimement liées. Dans L’interprétation des rêves, Freud raconte ses propre rêves, même s’il le dissimule à certains moments. Petite fille, j’avais découvert qu’on pouvait parler de psychanalyse sous forme de journaux. Quand j’ai commencé ma propre analyse, j’ai écrit mes séances pendant plusieurs années avec le projet d’en faire un livre, mais des cambrioleurs ont emporté un certain nombre de mes journaux personnels et je ne les ai jamais retrouvés. C’est donc le livre manquant, le trou… Ma psychanalyse était pour moi très liée au fait d’écrire ces séances. Les mots pour le dire de Marie Cardinal est une lecture qui m’a marquée. L’oralité de l’analyse est très investie émotionnellement, ce n’est pas exactement celle de la vie sociale…
AD : Faites-vous une distinction entre vos articles de sciences humaines, vos essais et vos ouvrages plus intimes, dans lesquels vous vous livrez à l’autofiction ?
LF : Non, je ne crois pas. Tout ça, c’est le même tissu. Écrire est très largement autofictionnel, même quand on a d’autres sujets que soi. Il y a parfois des prétextes pour se mettre à écrire, mais même mes livres sur Freud et Casanova sont autobiographiques. Quand je m’interroge sur la judéité de Freud, c’est une recherche miroir de ma propre vie. Les personnages que l’on invente sont des prétextes, ils naissent de nos interrogations, parfois de notre expérience ou plus largement de notre empathie. Certains livres sont nés de commandes, mais je m’investis toujours très fort dans tout ce que j’écris : j’écris avec des parts de moi, je fais mien le sujet. Ce qui m’importe, c’est de tester des expériences différentes. Il faut que chaque livre soit un défi, qu’il y ait un enjeu, sinon ça m’ennuie. Je ne vois aucun intérêt à me répéter. La Reine Alice, par exemple, est né des photos que j’ai prises pendant ma maladie, et que je postais sur un blog.
AD : Quand vous avez commencé à écrire Comment j’ai vidé la maison de mes parents, vous n’aviez pas prévu d’en faire une trilogie, ni d’écrire un autre livre qui y revienne, vingt ans après, Que ce soit doux pour les vivants…
LF : Non, pas du tout. Le déclencheur a été de trouver ces serviettes en papier rapportées de voyages, sur lesquelles ma mère avait inscrit la date et le lieu d’origine. J’ai écrit ce livre en cachette, comme si je n’étais pas autorisée à parler des sentiments qui me traversaient. Il existait déjà beaucoup de livres sur le deuil mais personne n’en parlait de façon concrète : « l’orage émotionnel » procuré par le fait de fouiller les archives, les tiroirs, les poches des défunts… À la fin du livre, je n’ai pas mis de point final car je vivais alors cette ponctuation comme très violente. Mon deuil n’était pas terminé, j’avais envie de garder mes parents en moi. Je n’avais en effet pas prévu la suite, qui m’a été lancée en boutade par un lecteur que j’ai rencontré dans une librairie. Tout s’est enchainé pour des raisons pas forcément conscientes…
AD : Était-ce difficile de vous livrer si intimement ?
LF : Ce livre a été un miroir pour de nombreux·ses lecteur·ices, il leur a permis de penser : « Mais je ne suis pas seul ! », et ça m’a beaucoup émue. Ce n’était pas un geste égoïste mais un « nous de partage », comme a dit Jacques De Decker quand j’ai été élue à l’Académie royale de langue et littérature françaises en 2009. J’ai été très surprise du succès incroyable que ce récit a rencontré, ça a été un cadeau incommensurable que des gens s’emparent de cette lecture pour eux-mêmes. J’ai voulu leur rendre hommage dans mon dernier livre, Que ce soit doux pour les vivants. On est très seul quand on écrit, on se retire du monde, et cela me fait toujours immensément plaisir de rencontrer mes lecteur·ices autour d’un livre, je suis toujours émerveillée par les échanges que cela suscite.
AD : Avoir écrit sur l’histoire de vos parents, tous deux rescapés de l’Holocauste, vous a-t-il procuré une forme d’apaisement ?
LF : Dans mon dernier livre, je raconte comment le trauma traverse le temps et comment la réparation, la cicatrisation, interviennent progressivement. Quand j’ai pris la parole lors des cérémonies de lecture des noms au Mémorial de la Shoah, ce qui m’a le plus frappée n’est pas d’avoir prononcé les noms des membres de ma famille mais aussi ceux d’autres disparu·es, notamment cette famille de Constantinople et leurs cinq enfants, dont j’ai dit le nom et l’âge de chacun. Offrir une forme de dignité est très réparateur au-delà de mon histoire personnelle ; c’est une recherche d’humanité beaucoup plus large. Le fait que ça se passe en public est fondamental : tant qu’on vit ça seul dans le silence, la réparation ne peut pas advenir, elle doit être collective. La honte change de camp quand le mouvement devient collectif. J’ai aussi pu écouter le témoignage audio de ma mère s’adressant à deux jeunes historiens qui l’interrogeaient sur ses activités de résistante et sa déportation. Sa voix était celle d’une femme combattive et confiante. Ce n’était plus seulement entre elle et moi : ça m’a permis de devenir un témoin comme tant d’autres, de l’écouter autrement et d’être immensément fière d’elle parce que je n’étais plus happée comme l’enfant-éponge que j’étais auparavant. Quand j’étais petite, je ressentais beaucoup de choses que je ne pouvais pas formuler. Un enfant veut à tout prix réparer ses parents sans savoir comment faire. Aujourd’hui je me demande : aurais-je été capable de faire comme elle ? Était-elle courageuse ou un peu inconsciente ? J’aimerais lui dire tout cela, mais on est toujours décalé dans le temps…
AD : En tant que femme issue d’une mère rescapée des camps de concentration, quel sentiment vous procure l’actualité internationale ?
LF : Maurice Olender, mon compagnon, parlait de son pessimisme tonique. Moi, je suis plus souvent optimiste, mais je dois reconnaître qu’au niveau planétaire, c’est actuellement très difficile de le rester. Je veux résister comme ma mère a été capable de le faire, y compris à travers l’art et la science. Il faut continuer avec conviction à faire ce qu’on a à faire, à créer de toutes les manières possibles – c’est notre seule force. L’être humain est une espèce dangereuse, et pourtant, je ne veux pas abandonner. J’aime l’idée que des choses s’inventent encore et toujours.
AD : Et les questions de genre, comment vous font-elles réagir ?
LF : J’ai eu beaucoup de chance dans la vie. Pour mon père, avoir une fille avait autant de valeur qu’un garçon. Je ne me suis pas sentie empêchée. Comme écrivaine et psychanalyste, je n’ai pas rencontré de difficultés, même si je sais qu’il y a là, comme partout, des abus de pouvoir. Mon père était très maternant, mes parents avaient des idées très modernes, alors j’ai cherché consciemment un homme qui savait cuisiner – ça me semblait indispensable ! On m’a souvent dit, à propos de mon couple : « Mais tu ne te rends pas compte de la chance que tu as de pouvoir être encouragée et faire carrière sans jalousie ni ambivalence ! » Maurice était très conscient que la langue véhiculait les violences contre les femmes, qu’il fallait changer la langue pour changer les mentalités. J’ai pris conscience de certaines choses seulement récemment, tant ma vie m’a semblé libre, et j’en suis un peu gênée. Je pense que si les pères et les mères ne donnent pas d’emblée à leurs bébés filles les mêmes droits et la même place, ça ne marchera pas.
AD : Quel regard portez-vous aujourd’hui sur votre parcours ?
LF : C’est du cousu main (rires). Me retourner sur mon chemin ne m’intéresse pas tellement, je préfère penser au prochain livre que j’aimerais écrire. J’ai été très gâtée dans la vie : je n’avais que 33 ans quand je suis passée à Apostrophes, je me suis sentie reconnue très tôt, j’ai été traduite dans vingt langues, aujourd’hui je suis lue et analysée par des universitaires du monde entier, c’est extraordinaire. La gratitude, oui, c’est un mot qui me parle. Remercier les gens qu’on a rencontrés, ce qu’on doit aux autres… L’écriture est là depuis toujours j’en suis infiniment heureuse, comme d’avoir rencontré Maurice, avec qui j’ai fait ce chemin. Et je suis quand même heureuse d’être entrée tout récemment dans Le Petit Larousse 2025 !
Propos recueillis par Aliénor Debrocq
Pour aller plus loin
. Découvrir l’ensemble du Palmarès 2024
