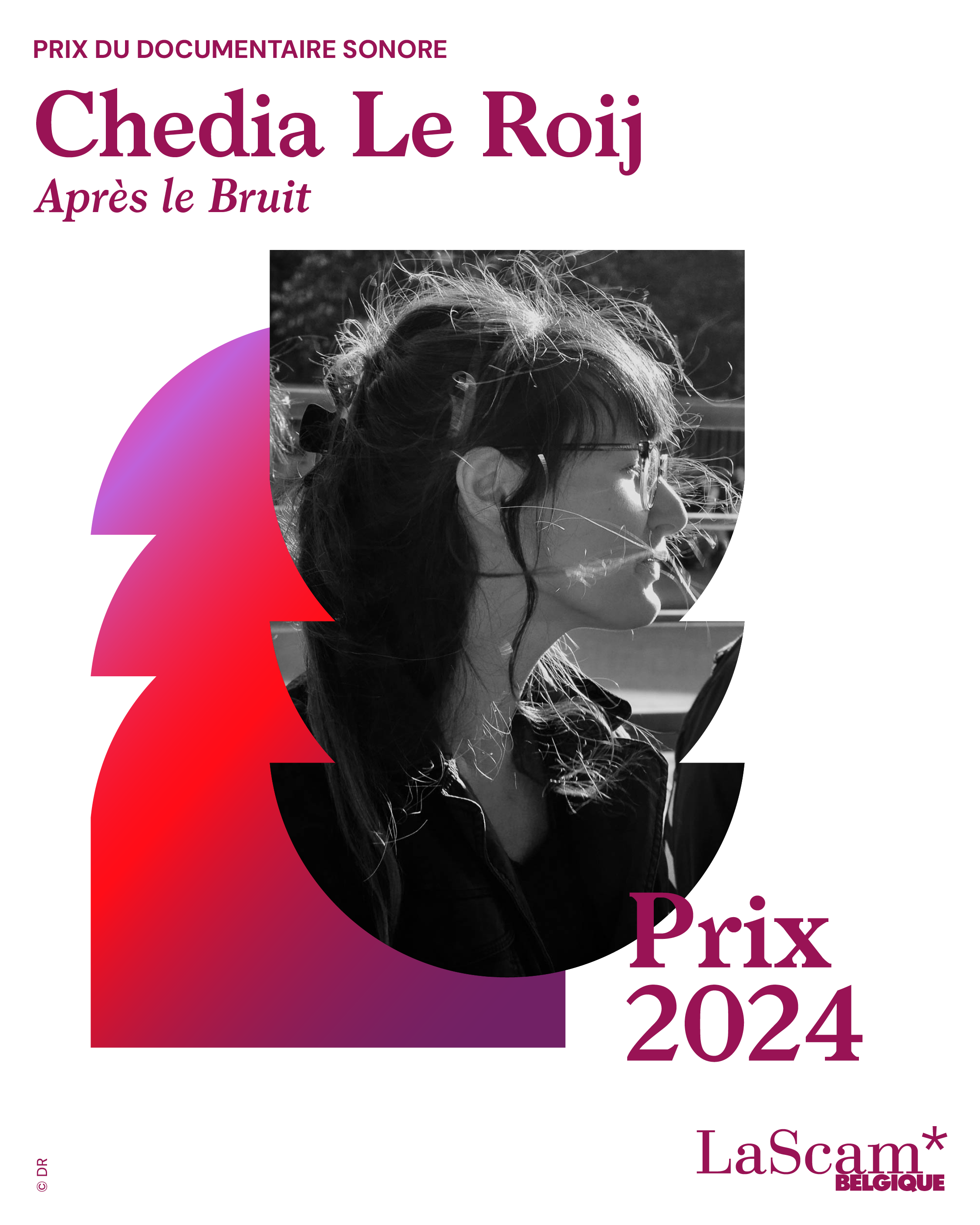Coup de projecteur sur Chedia Le Roij, Prix Scam 2024 du documentaire sonore pour Après le bruit
« Et si le documentaire c’était l’art de bifurquer ? Au risque de changer le regard qu’on a sur le monde, de l’élargir, en dirigeant ses pas, ses oreilles, et son attention vers l’autre. Au risque de s’y relier. C’est l’invitation de Chedia Le Roij» : quelques mots pour se plonger dans l'univers de Chedia Le Roij, qui reçoit le Prix Scam 2024 du documentaire sonore pour Après le bruit. Découvrez à cette occasion l'éloge écrit en son honneur par le Comité ainsi qu'un entretien passionnant avec elle.

L'éloge du Comité
Et si le documentaire c’était l’art de bifurquer ? De prendre la route, une autre route que celle qui était prévue, de se laisser prendre le temps de faire un détour, et même de prendre la tangente ? Au risque de changer le regard qu’on a sur le monde, de l’élargir, en dirigeant ses pas, ses oreilles, et son attention vers l’autre. Au risque de s’y relier. C’est l’invitation de Chedia Le Roij, sur les rives de la Vesdre. Un an après les inondations dévastatrices, elle s’y arrête et nous y transporte. Pas à pas, avec finesse et humilité, elle construit un récit avec les habitants qu’elle rencontre.
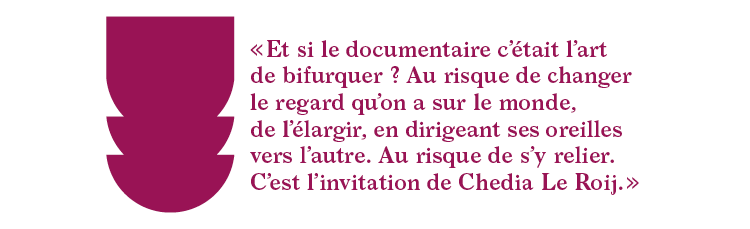
Sur notre écran intérieur il y a l’eau et sa puissance inarrêtable. Tout ce qu’elle a charié et emporté sur son passage. Puis, peu à peu, se déposent les éléments fracassés, essorés, décantés. Un à un, Chedia les cueille et les rassemble avec tact et douceur.
Et ils s’impriment en nous. Il y a le paysage transfiguré par l'industrie féroce, les ouvrier.es venu.es de si nombreuses contrées, leurs carrés de terre au bord de cette rivière multicolore. Il y a les maladies d’après le choc. Il y a la solidarité. Il y a l’avenir. Incertain. Les fissures. Il y a toutes les questions. Celles posées, celles en suspens, celles effleurées à demi-mot, celles qu’on imagine.
Et si on écoutait ce/ceux que la terre a remué.es? Et si on prenait une autre route ?
Muriel Alliot, membre du Comité belge de la Scam
« Après le bruit, le son »
Après un master en sciences politiques à l’ULB, Chedia Le Roij découvre la réalisation radio en co-réalisant le documentaire What’sup Dock ? avec Clara Alloing. Depuis, elle a suivi plusieurs formations liées au son, a réalisé de nombreux courts documentaires diffusés sur diverses radios associatives et a co-animé des ateliers radio. Elle a également réalisé la série documentaire Le Mécano de l’Evasion. Après le bruit, son dernier documentaire sonore, reçoit aujourd’hui le Prix Sonore de la Scam. Rencontre.
Juliette Mogenet – Depuis une dizaine d’années, tu réalises des documentaires et tu participes à diverses expériences sonores. Peux-tu nous parler de ton parcours ? Comment as-tu commencé puis continué à travailler le son ?
Chedia Le Roij – Le commencement, c’était fin 2014. Une de mes amies était réalisatrice radio, sortie de l’Insas, et on est allées manifester ensemble, après le premier passage de la N-VA au pouvoir. Les dockers d’Anvers sont arrivés à Bruxelles et ont mis le dawa dans la manifestation. Ce qu’il s’est passé était intéressant, et elle m’a proposé qu’on fasse une création radiophonique sur les dockers du port d’Anvers. On a fait des repérages, puis on a eu la possibilité grâce au FACR (Fonds d’aide à la création radiophonique) de mener le projet à bien. C’est une aide géniale, qui permet de mettre le pied à l’étrier en soutenant notamment des premières réalisations sonores. Moi je viens plutôt des milieux militants, j’ai passé dix ans dans des collectifs, et la radio m’a permis d’aller un peu voir en-dehors, de trouver une autre place par rapport à ces enjeux politiques et militants, de continuer à les traiter via le format radiophonique. J’ai poussé la porte de Radio Panik, qui est aussi un lieu d’expérimentation, un peu comme l’ACSR (atelier de création sonore et radiophonique) : on a ici un écosystème qui offre des espaces-temps très précieux pour tester des formes sonores, réaliser ses premiers docus, faire des rencontres avec des personnes du secteur de la radio… On peut faire des erreurs, se tromper, réessayer : c’est inestimable ! J’ai aussi collaboré avec Radio Canut, et je fais partie d’une asbl de production radiophonique qui s’appelle « Le bruit et la fureur ». Je suis membre d’une autre asbl qui produit et diffuse des créations radio « Par chemin et ruines », et je suis membre de l’ASAR (Association des Auteur·ices et métiers de la création radiophonique) depuis deux ans.
JM – Dans chacun de tes projets, tu tends le micro à des personnes qui ont une expertise de vécu sur des réalités sociales ou sociétales souvent rendues inaudibles habituellement. J’ai la sensation que tu amènes les auditeur·ices, en découvrant ces voix, à interroger leur propre rapport aux institutions (comme la prison ou le travail) mais aussi à réfléchir aux fils invisibles qui se tissent entre les personnes directement confrontées à la violence des institutions (comme les détenu·es) et celles et ceux qui se sentent moins concerné·es par ces réalités, alors que l’ensemble de la population l’est pourtant.
CLR : Oui ! J'ai été longtemps engagée dans des collectifs qui dénonçaient le rôle de la prison et les conditions de détention. Plus tard, j'ai aussi fait partie de la commission de surveillance de la prison de Saint-Gilles. Je m’intéresse de près à la façon dont on traite cette partie de la population qui est incarcérée. Après les attentats, il y a eu une vague répressive et beaucoup de personnes étaient alors en régime d’isolement en prison. J’ai réalisé « Le Mecano de l’evasion » (grâce au FACR à nouveau, et à l’ACSR) à partir de ces questions-là. Concernant la prison, il n’y a pas de doute sur le fait qu’on ne peut pas appliquer une forme de violence à une partie de la population et espérer que ça n’ait pas d’impact sur le reste de la population d’une façon ou d’une autre.
De plus en plus, je m’intéresse à des sujets ou des personnes qui subissent soit une violence, soit une indifférence. Certain·es se rassurent en pensant que la violence sociale ou les mesures répressives sont cantonnées à une partie de la population, mais d’une part l'histoire montre que les mesures d'exception se généralisent souvent à l'ensemble de la population. D'autre part, que l'on subisse ou que l'on produise de la violence sociale, même par indifférence, ça met en jeu notre humanité.
On est dans une société qui précarise de plus en plus et des couches des plus en plus larges de la population : migrant·es, prisonnier·es, allocataires sociaux… La précarité et le mépris social ne sont pas des expériences dont je me sens éloignée. Ça m’intéresse d’essayer de construire des objets sonores qui peuvent permettre à d’autres personnes de se relier à ces expériences-là. C’est ma manière de participer depuis là où je suis à la construction d'un milieu au sens environnemental, à un agencement de multiples actions et propositions, agencement dont j'espère qu'il puisse créer une différence.
JM – Après le bruit qui reçoit aujourd’hui le prix Sonore de la Scam, est tissé de témoignages d’habitant·es de la vallée de la Vesdre marqué·es par les inondations de l’été 2021. La catastrophe climatique est mise en lien avec l’histoire de l’industrialisation de la région. Les catastrophes écologiques et sociales entrent en écho à la fois sonore et historique. Comment as-tu construit ce projet : d’où t’en est venue l’envie, l’idée ?
CLR – Il y a toujours plusieurs généalogies à un projet : je n’étais pas en Belgique au moment des inondations, j’ai vu les images de la catastrophe de loin, puis les images de solidarité qui m’ont marquées. Je m’intéresse aussi depuis toujours aux questions environnementales, notamment concernant la question nucléaire. Je venais de faire un projet avec La Bellone en sortant du Covid : une récolte de témoignages notamment sur la manière dont les personnes s’étaient organisées pendant le covid pour pallier les manques des institutions. Je voulais continuer sur cette ligne-là et aller rencontrer les personnes qui avaient débarqué dans la vallée pour soutenir les sinistré·es. Un ami liégeois m’a fait rencontrer plusieurs des protagonistes du documentaire, c’est lui qui m’a donné les premiers renseignements sur le fait que Verviers était la première ville industrialisée sur le continent. La question ouvrière me travaille aussi beaucoup : en Belgique, il y a peu d’entretien de la mémoire des luttes ouvrières. Globalement, on a un problème sur le rapport à l’histoire en Belgique : notamment par rapport à notre histoire coloniale (heureusement, c'est en train de changer), mais pas uniquement. C’est en arrivant dans la vallée que j’ai appris cette histoire industrielle et ça m’a marquée. Si on tire le fil, le changement climatique c’est la conséquence de cette époque industrielle où les modes de vie de toute une partie de la population ont été complètement désarticulés : ils sont passés d’une vie paysanne plus ou moins autonome à une vie de travail ouvrier dans les industries du bas de la vallée dans les conditions ignobles qu'on connaît bien. Ils ont en quelque sorte vécu une catastrophe et c'est par la construction des organisations ouvrières que ces populations ont reconstruit des conditions de vie dignes.
Il y a quelque chose qui m'interroge dans la relation entre cette catastrophe passée et celle des inondations. Nous sommes entré·es dans une époque de grands désastres environnementaux qui découlent de l'industrialisation du monde et dans laquelle, sans avoir complètement disparu, les solidarités du monde ouvrier sont très affaiblies. Mais parfois, étonnamment, des solidarités surgissent de là où on ne s'y attendait pas. Dans la vallée, ça a été le soutien en masse de flamands qui sont venus nettoyer, reconstruire... parfois jusqu'à deux ans après le début du sinistre. C'était important pour moi de relayer autant l'expérience des inondations que celle de cette solidarité par le bas (et non pas des institutions).
JM – Comment as-tu concrétisé ce projet ? Quels choix de traitement sonore as-tu faits ?
CLR – J’ai été financée par le FACR et par la bourse Gulliver pour ce projet. J’ai fait plein d’allers-retours sur place, je suis allée plusieurs fois rencontrer certaines personnes, j’ai pas mal circulé entre Fraipont, Nessonvaux, La Brouck et Verviers. Je suis allée aux commémorations, aux barbecues. En tout, j’avais 55h de rushes. Paola Stévenne m’a aidée à m’y retrouver et à tisser le cheminement de la réalisation.
Il y a plusieurs moments d’ambiance sonore : c’était important pour moi de faire entendre la vallée. Il y a des passages plus en lien avec le passé industriel, qui sont aussi des expérimentations : compositions acousmatiques ou sons bruts des archives d’enregistrements des inondations, qui permettent aussi de faire sentir la puissance de ce qu’il s’est passé. J’avais envie de construire quelque chose avec une continuité des sons, comme un voyage dans la parole et dans les paysages qui se déploient derrière la parole. Il y a une sorte de paysage sonore en permanence à l’arrière, qui forme une sorte de trajet : on démarre avec Madeleine et Rufino dans les hauteurs de La Brouck et on termine aussi avec eux, chez eux.
JM – C’est quoi, la suite, pour toi ?
CLR – J’ai présenté un projet au FACR pour continuer à travailler autour des gestes qui humanisent ou déshumanisent, mais je n'en dis pas plus, on verra s'il est financé.
Propos recueillis par Juliette Mogenet
Pour aller plus loin
. Découvrir l'ensemble du Palmarès 2024
. Ecouter ses oeuvres sur Radiola